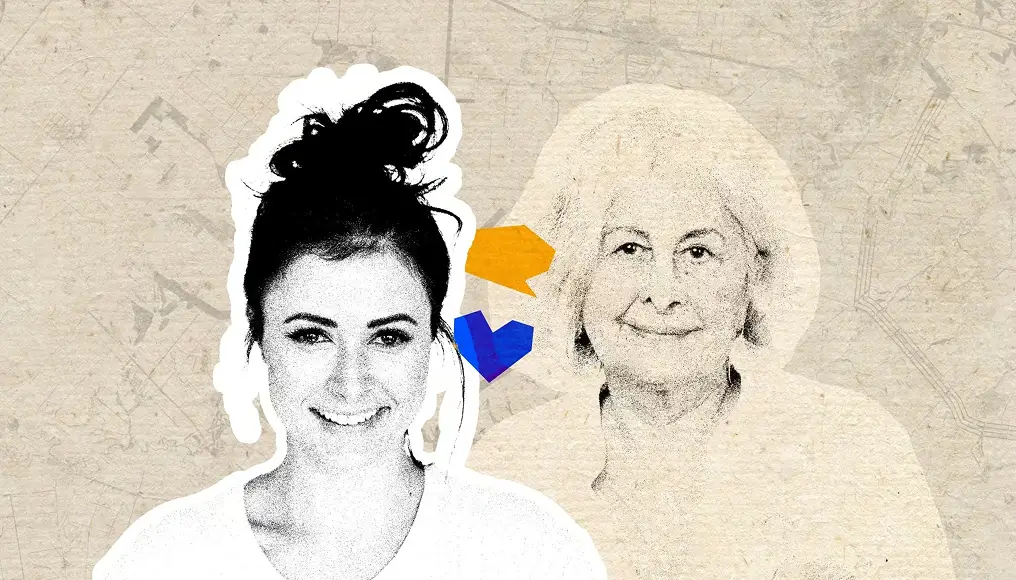Shrinkflation et immobilier : surfaces plus petites pour prix plus hauts
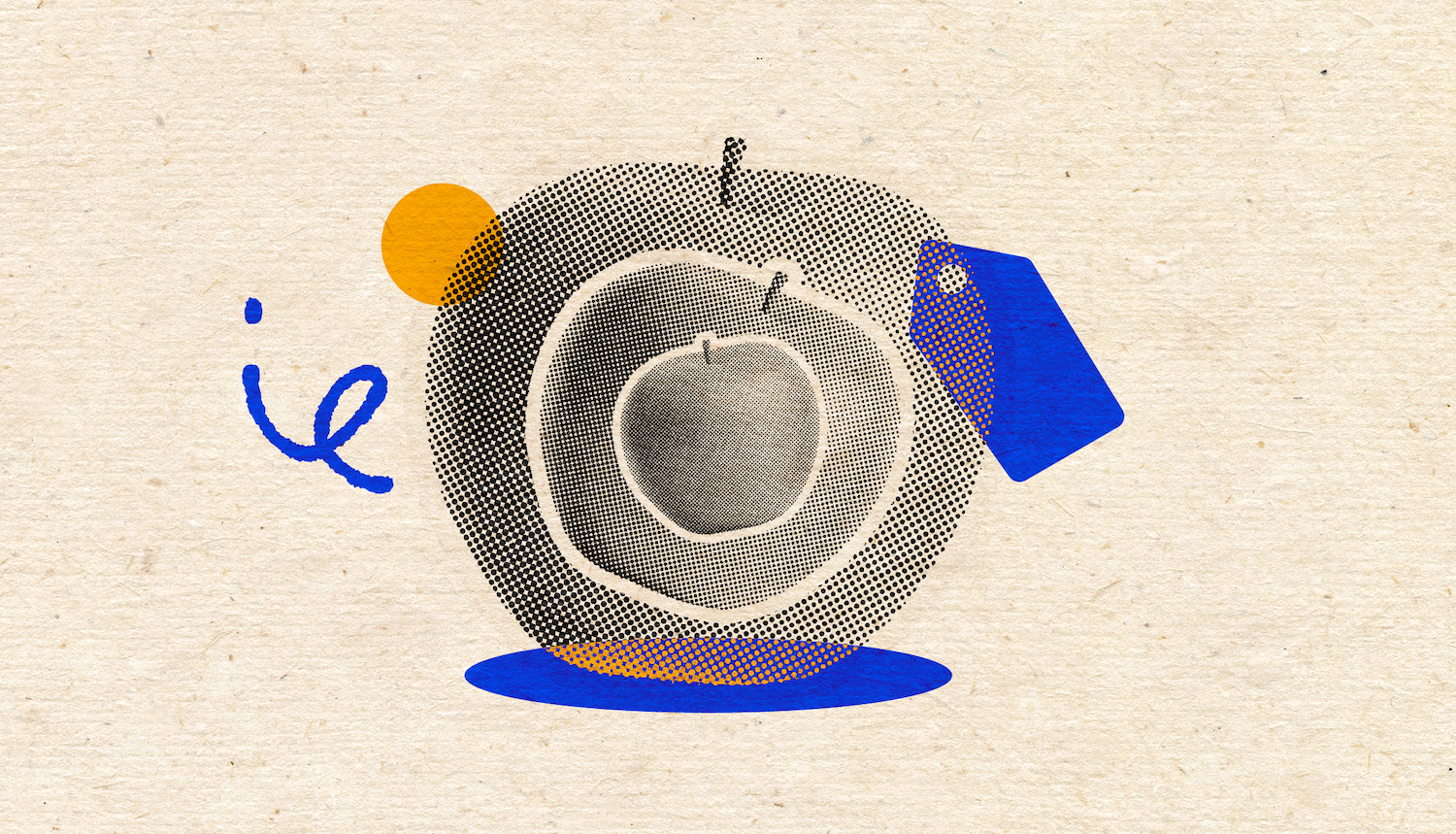
Si vous avez déjà eu l’impression de payer plus cher pour moins, vous avez probablement été victime de la shrinkflation. Ce phénomène, autrefois réservé aux produits de grande surface, touche désormais l’immobilier : des surfaces plus petites, des prestations au rabais… mais des logements vendus à prix d’or.
Au départ, c’était juste votre tablette de chocolat. Puis le paquet de chips. Puis le papier toilette, la pâte à tartiner et même le dentifrice. Le prix ne bougeait pas (trop), mais le contenu, lui, se faisait la malle. Cette stratégie porte un nom : la shrinkflation. Et elle a dorénavant gagné un terrain inattendu : l’immobilier.
Oui, même votre futur chez-vous est victime du “moins pour plus”.
À première vue, les logements neufs ont toujours l’air attractifs, modernes, lumineux. Sauf que derrière les rendus 3D et les slogans bien sentis, une réalité s’installe : les mètres carrés s’évaporent doucement, les prestations s’étiolent, les volumes se réduisent. Les prix, eux, en revanche, continuent de grimper.
Que se cache-t-il derrière la shrinkflation immobilière ? Le logement est-il en train de devenir un produit de consommation comme un autre ?
On vous décrypte cette tendance chez les promoteurs immobiliers : vendre plus petit, plus loin… mais pas moins cher.
Quand les maisons rétrécissent
Victor Habchy, 33 ans, a monté un concept qui marche : Le Guide Ultime. Ils sont 1,3 million de personnes à avoir suivi sur Instagram ses recommandations d’adresses à Paris et ailleurs. Quand on le contacte, il vient tout juste de revendre ses parts à son associée. Bref, sur le papier, Victor a tout du bon candidat pour acheter un bien immobilier.
Pourtant, la réalité l’a heurtée de plein fouet.
Victor a récemment acheté un appartement de 37 m² à Pantin, qu’il partage aujourd’hui avec son compagnon. À l’origine, leur rêve, c’était Paris. Mais après plus d’un an de recherches infructueuses, le couple était à deux doigts d’abandonner — quitte à ne jamais devenir propriétaires.
“Je ne m’attendais pas à ce que ce soit aussi compliqué. Acheter aujourd’hui, c’est forcément une affaire de compromis, que ce soit sur la surface, sur le DPE ou sur la localisation.”, confie-t-il.
Pourtant, pour Victor, devenir propriétaire a toujours été un objectif de vie, presque un symbole.
“Acheter sa résidence principale, c’est une forme de liberté. D’un coup, ton logement devient vraiment chez toi, tu sors d’un sentiment de précarité. Tu sais que personne ne pourra te mettre dehors”, commente Victor.
Après des dizaines de visites décevantes — entre studios exigus et appartements insalubres — c’est finalement sur Le Bon Coin, presque par hasard, qu’il découvre l’annonce qui changera la donne.
“Je suis tombé dessus un peu par chance. Je l’ai visité le lendemain, mon compagnon a fait une contre-visite dans la foulée, et on a fait une offre avant la fin de la semaine. Deux autres dossiers étaient déjà posés, il fallait aller vite. Oui, c’était plus petit et plus excentré que prévu, mais c’était le seul qui cochait presque toutes les cases.”, décrit Victor.
Aujourd’hui, Victor garde un goût amer de cette “chasse au logement” au prix fort :
“Le logement, c’est un besoin vital. Et pourtant, c’est devenu un produit de consommation comme un autre. Dans un monde dans lequel les écarts de richesse se creusent, c’est un vrai catalyseur d’inégalités.”
“Je ne m’attendais pas à ce que ce soit aussi compliqué."
Malheureusement, le cas de Victor est loin d’être isolé. En France, c’est même devenu la norme : pour faire face à la crise du logement, les promoteurs ont petit à petit rogné sur les mètres carrés.
Résultat : la surface des logements neufs fond discrètement. Dans les zones tendues, les T1 ont perdu entre 5 et 10 % de surface depuis 2021. Ce phénomène, appelé la shrinkflation, s’est même étendu outre-Atlantique.
Aux États-Unis, la taille médiane des logements est passé de 185 m² à 173 m² carrés en 5 ans, tandis que les prix ont bondi de 36% sur la même période.
Du côté des promoteurs, la shrinkflation est présentée comme une réponse d’adaptation face à plusieurs contraintes : la hausse des coûts de construction, la pression foncière dans les zones tendues, mais aussi l’évolution des modes de vie et des structures familiales.
Chez le constructeur Hexaom, par exemple, plus de 30% des clients sont aujourd’hui des personnes seules — souvent issues de familles monoparentales ou de séparations. Autrement dit, si les logements rétrécissent, c’est aussi parce que les ménages se fragmentent.
Les besoins changent, alors l’offre aussi.
La shrinkflation, le symptôme d’un modèle urbain à bout de souffle
Mais réduire la surface de nos logements pour permettre aux propriétaires d’acheter en zones urbaines met surtout en lumière les limites d’un modèle urbain qui s’essouffle.
Dans les grandes villes françaises, comme dans bien d’autres métropoles occidentales, la shrinkflation immobilière révèle une impasse : celle d’un urbanisme compressé, qui tente de faire entrer toujours plus d’habitants dans toujours moins d’espaces.
En diminuant les surfaces, on fragilise la qualité de vie, on raréfie les espaces verts et on accentue la ségrégation démographique. Petits logements pour les jeunes actifs et les ménages modestes ; familles qui fuient dans les quartiers les plus résidentiels ou les banlieues chics.
À long terme, ce modèle peut affaiblir l’attractivité des centres-villes. Là où le logement devrait être un levier de mixité et de vitalité urbaine, la shrinkflation risque de devenir un facteur de déclassement et de décrochage. Une alerte silencieuse, mais sérieuse, sur la nécessité de repenser la densité — non pas en mètres carrés gagnés, mais en qualité de vie partagée.