Comment se logeaient les Parisiens dans le milieu ouvrier du XIXᵉ siècle ?
.webp)
Au XIXᵉ siècle, le logement avait un rôle très fonctionnel. Il était perçu comme un simple abri, et pas du tout comme un objet d’attachement comme c’est le cas à l’heure actuelle. Mais alors, comment vivait le peuple parisien dans le milieu ouvrier de la Belle-Époque ? Décryptage.
Vivre les uns sur les autres
Dans toutes les sociétés fondées à l’origine sur l’agriculture sédentaire, se loger apparaît comme une nécessité vitale. Toutefois, les habitants de la Belle-Époque avaient un rapport au logement… bien différent du nôtre.
Insalubrité, équipements rudimentaires, entassement des individus dans des pièces minuscules… Les travaux de différents historiens, à l’instar de Marie-Jeanne Dumont ou encore de Michelle Perrot, confirment que le logement au XIXᵉ siècle avait un rôle purement fonctionnel. Il s’agissait d’abord et avant tout d’un lieu pour dormir, dont le principal intérêt était d’être clos. Un toit, si on veut, mais certainement pas un foyer donc.
Il n’y avait pas de vie intime ni de vie privée. On pouvait vivre les uns sur les autres, sans délimitation d’espace ni de meubles à soi.
“Si le logement était réellement ressenti comme un simple abri, pas question […] qu’il ait été l’objet d’un quelconque attachement, ni même qu’on ait eu l’idée de revendiquer ou de souhaiter quelque chose de mieux. Autant les ouvriers savaient critiquer leurs conditions de travail et se battre pour les améliorer, autant ils auraient été indifférents à leurs conditions de logement”. Alain Faure, Comment se logeait le peuple parisien à la Belle Époque ? (Vingtième Siècle. Revue d'histoire. 1999).
Autant les ouvriers savaient critiquer leurs conditions de travail et se battre pour les améliorer, autant ils auraient été indifférents à leurs conditions de logement.
Garnis, chambrées… les spécificités du logement ouvrier au XIXᵉ siècle
Mais alors, à quoi ressemblaient ces logements parisiens de la Belle-Époque ?
Il y en avait plusieurs types. En périphérie de Paris, aux alentours de 1890, il était commun de retrouver des maisons basses, souvent sur cour, et composées de 2 ou 3 pièces maximum.
Mais ce qu’on trouvait le plus à Paris et qui séduisait les milieux ouvriers du XIXᵉ siècle, c’étaient les garnis. Des hôtels populaires, avec des chambres déjà meublées, qui étaient originellement destinées aux nouveaux arrivants à Paris. Dans leur ouvrage Une chambre en ville, Alain Faure et Claire Lévy-Vroelant étudient les hôtels meublés et les garnis de Paris. Le constant est clair : l’habitat en hôtel meublé avait répondu, du moins en partie, aux besoins de logement de la population ouvrière, souvent jeune et pauvre, qui arrivait à Paris pour intégrer une formation ou chercher un emploi.
Dans un garni, il y avait généralement deux options :
- Des chambres individuelles
- Des chambres collectives, appelées “chambrées”
Il n’était pas rare non plus que les entreprises mettent la main à la pâte pour recruter de la main d’œuvre. Au XIXᵉ siècle, à Paris, lorsqu’on travaillait dans des cafés, des grands magasins, chez le boucher ou dans la restauration, habituellement, on était nourris et logés. C’est ce qu’on appelait des “métiers couchés”.
Avoir des meubles pour se sentir chez soi
Finalement, un point commun réunit tous ces logements parisiens du milieu ouvrier du XIXᵉ siècle : ils étaient meublés. En effet, posséder ses propres meubles était souvent un signe d’émancipation et d’ascension sociale.
Pour répondre à cette demande, il existait des magasins de vente à crédit, à l’instar des magasins Crespin-Dufayel, qui permettaient aux jeunes ménages de se meubler en versant régulièrement des petites sommes.
Ainsi, avoir un mobilier, même modeste, constituait le signe d’une indépendance, mais aussi un certain gage de sécurité : si les choses tournaient mal, il était toujours possible de placer ses meubles en gage plus tard ou de les revendre.
En somme, à la Belle-Époque, avoir des meubles, c’était sortir des garnis et des hôtels populaires, avoir une certaine assise dans la vie parisienne et donc… se sentir davantage chez soi.




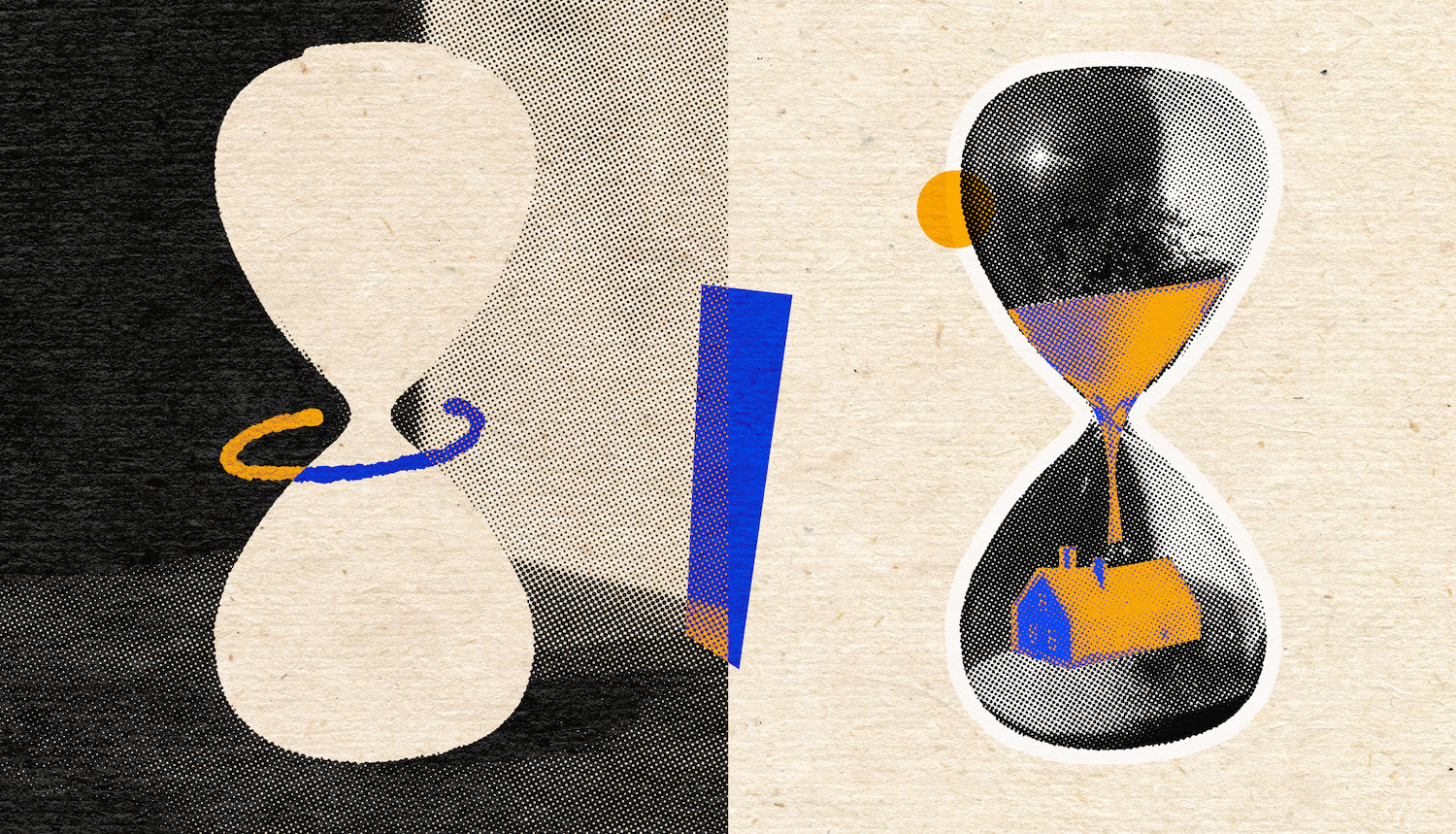
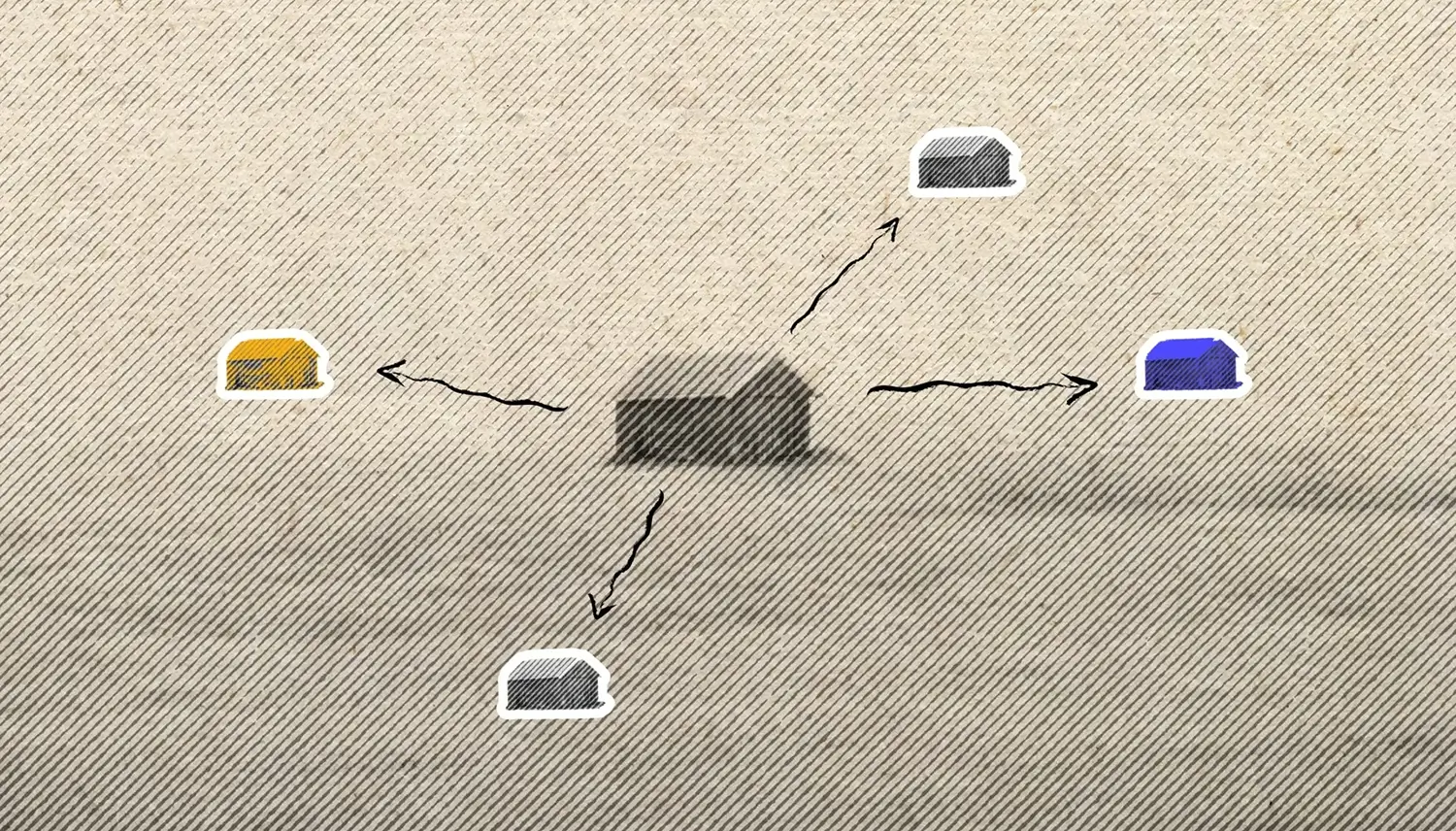
.avif)



