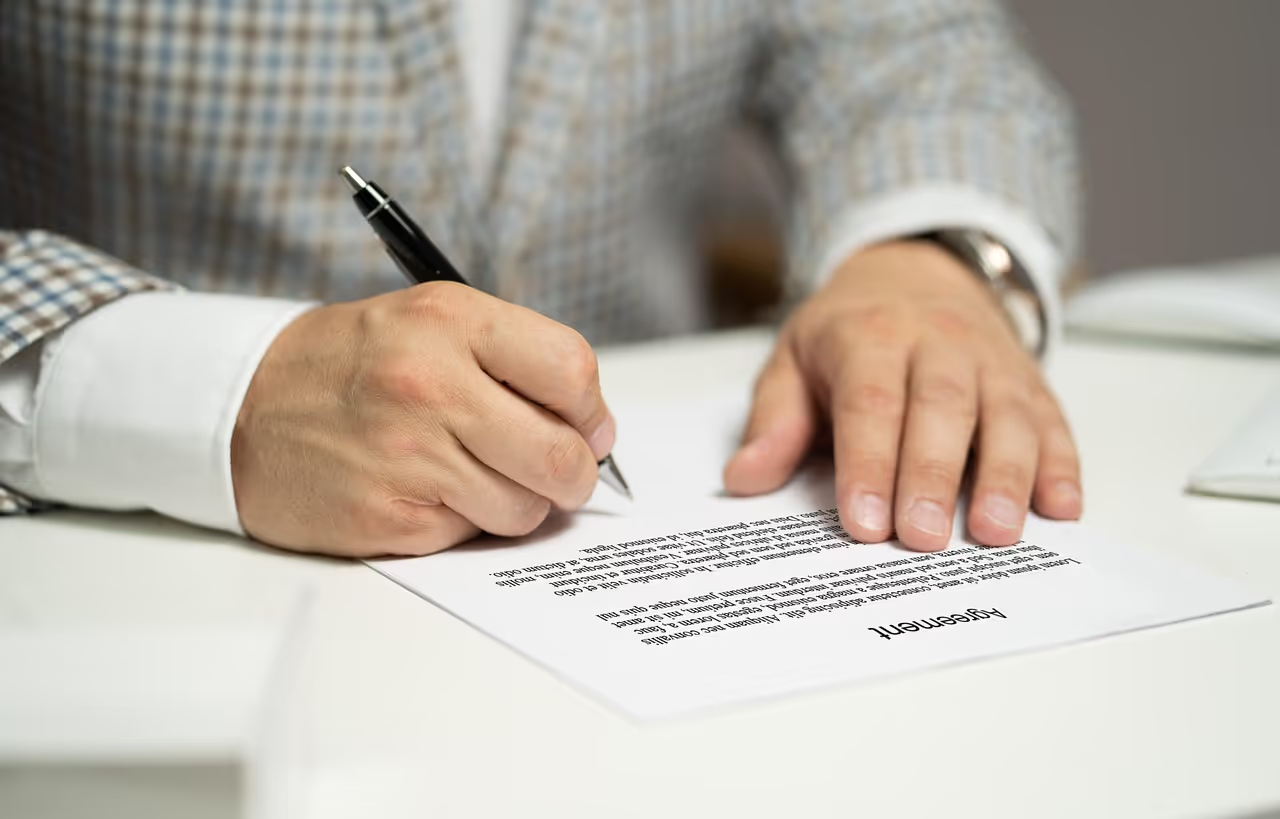Définition de la promesse de vente et du compromis
Avant de choisir entre promesse et compromis, il est important d’en comprendre le fonctionnement juridique, le niveau d’engagement de chaque partie et les effets pratiques sur la vente.
Qu’est-ce qu’une promesse unilatérale de vente ?
La promesse unilatérale de vente (PUV) est un contrat par lequel le vendeur s’engage à vendre un bien immobilier à un prix déterminé à un unique acheteur. Ce dernier dispose d’un délai d’option, généralement de 2 à 3 mois, pour décider d’acheter ou non. Pendant cette période, le vendeur ne peut pas proposer le bien à quelqu’un d’autre.
En pratique :
- Engagement du vendeur uniquement.
- L’acheteur est libre de lever ou non l’option.
- L’acheteur verse une indemnité d’immobilisation (souvent 5 à 10 % du prix de vente).
- Si l’acheteur renonce, cette somme reste acquise au vendeur.
La promesse est souvent privilégiée lorsque l’acheteur n’est pas encore totalement sûr (obtention du crédit, validation du projet, étude des diagnostics, etc.).
Qu’est-ce qu’un compromis de vente ?
Le compromis de vente (aussi appelé promesse synallagmatique) est un accord réciproque devant un notaire : le vendeur s’engage à vendre et l’acheteur s’engage à acheter. Il s’agit d’un véritable contrat : chacune des parties a des obligations précises et la vente est juridiquement formée, sous réserve des conditions dîtes suspensives (ex : obtention du prêt immobilier).
En pratique :
- Engagement du vendeur à vendre à ce prix à l’acheteur
- Engagement de l’acheteur à acheter à ce prix si il parvient à réunir les fonds nécessaires. Il y a souvent des conditions spécifiques notées : montant de l’emprunt, taux, etc … On parle ainsi de condition suspensive.
- Si l’acheteur souhaite se rétracter (après le délai légal de 10 jours), il doit donner 5 à 10% du prix du bien au vendeur
Ainsi, sauf clause de rétractation ou condition suspensive, aucune des parties ne peut se désister sans conséquence.
Les points communs entre les deux avant-contrats
Quelles sont les principales différences à connaître ?
Même si ces deux contrats semblent proches, leurs effets juridiques et financiers diffèrent fortement. Ces distinctions doivent être comprises avant de s’engager.
Engagements du vendeur et de l’acheteur
Dans une promesse unilatérale de vente, seul le vendeur s’engage à céder le bien. L’acheteur, appelé bénéficiaire, dispose d’un droit exclusif d’achat durant le délai convenu. Il n’est donc pas encore tenu d’acheter. S’il décide de ne pas lever l’option, il perd simplement l’indemnité d’immobilisation.
Dans un compromis, les deux parties sont engagées dès la signature. Si l’une d’elles refuse d’aller au bout, l’autre peut demander l’exécution forcée de la vente ou des dommages et intérêts. C’est donc un contrat plus contraignant mais aussi plus sécurisant juridiquement.
Conséquences juridiques et financières
Le niveau d’engagement conditionne le risque financier :
- En cas de promesse, seul le montant de l’indemnité est en jeu.
- En cas de compromis, le refus d’acheter ou de vendre peut entraîner des sanctions judiciaires.
Sur le plan fiscal, les différences sont aussi notables :
- La promesse doit être enregistrée au service des impôts (droit fixe de 125 €).
- Le compromis, lui, n’a pas d’obligation d’enregistrement, sauf s’il est notarié.
Délai de rétractation et conditions suspensives
Dans les deux cas, l’acheteur bénéficie d’un délai légal de rétractation de 10 jours (article L271-1 du Code de la construction et de l’habitation).
Ce délai commence à courir le lendemain de la réception du contrat signé. Les conditions suspensives permettent de sécuriser l’opération. La plus fréquente est celle relative à l’obtention du crédit immobilier : si le prêt n’est pas accordé, la vente est annulée sans pénalité.
Néanmoins, d’autres conditions peuvent être prévues :
- Droit de préemption de la mairie,
- Absence de servitudes ou d’hypothèques,
- Obtention d’un permis de construire (dans le cas d’un terrain).
Quel avant-contrat choisir selon votre situation ?
Le choix entre promesse et compromis dépend de votre profil, de votre projet et du niveau de certitude de la transaction.
Achat entre particuliers ou via une agence
- Entre particuliers, la promesse de vente est souvent privilégiée : elle laisse plus de liberté à l’acheteur et sécurise le vendeur avec l’indemnité d’immobilisation.
- Via une agence immobilière, le compromis est généralement préféré, car il fige la vente et garantit la rémunération de l’agence dès la signature.
Vendeur pressé ou acheteur encore indécis : que privilégier ?
- Vendeur pressé ou sûr de sa vente → Le compromis de vente est plus adapté : il garantit que l’acheteur s’engage réellement.
- Acheteur prudent ou en attente de financement → La promesse offre plus de souplesse et limite les risques financiers en cas de désistement.
Coût, sécurité juridique et flexibilité : les critères de choix
Les étapes clés de la signature
Qu’il s’agisse d’une promesse ou d’un compromis, la signature suit un processus précis :
- Rédaction de l’avant-contrat (par le notaire ou un agent immobilier)
- Versement du dépôt ou de l’indemnité d’immobilisation
- Envoi du contrat à l’acquéreur (début du délai de rétractation)
- Obtention du prêt et levée des conditions suspensives
- Signature de l’acte authentique chez le notaire
Peut-on annuler un compromis ou une promesse de vente ?
Oui, mais sous certaines conditions :
- Durant le délai de rétractation (10 jours) → l’acheteur peut se désister sans pénalité.
- Non-réalisation d’une condition suspensive (ex. refus de prêt) → la vente est automatiquement annulée.
- Résiliation amiable → possible si les deux parties s’accordent.
En revanche, si l’acheteur se rétracte hors délai et sans motif valable, il perd son dépôt (ou l’indemnité d’immobilisation). Si le vendeur refuse de vendre après un compromis signé, l’acheteur peut le contraindre en justice à exécuter la vente.
Documents nécessaires pour la rédaction
Pour signer l’avant-contrat, le notaire doit disposer de plusieurs pièces justificatives :
Côté vendeur :
- Titre de propriété,
- Dernier procès-verbal d’assemblée générale,
- Règlement de copropriété,
- Diagnostics techniques (DPE, amiante, etc.),
- Informations sur les charges et travaux votés.
Côté acheteur :
- Pièce d’identité, justificatif de domicile,
- Simulation de financement ou offre de prêt,
- État civil complet pour l’acte.
En résumé : promesse ou compromis, lequel choisir ?
FAQ – Différence promesse de vente et compromis
Quelle est la meilleure option pour mon projet immobilier ?
Le compromis est plus engageant mais plus sécurisant. La promesse offre davantage de souplesse.
Quels sont les coûts associés ?
125 € pour l’enregistrement d’une promesse sous seing privé. Le compromis n’entraîne pas de coût administratif particulier.
Comment se passe la signature ?
Chez le notaire ou sous seing privé. L’acheteur dispose toujours de 10 jours pour se rétracter.
Peut-on annuler un compromis ou une promesse ?
Oui, pendant le délai de rétractation ou si une condition suspensive n’est pas remplie.
Quelles informations fournir au notaire ?
Titre de propriété, diagnostics, informations sur la copropriété et identité complète des parties.